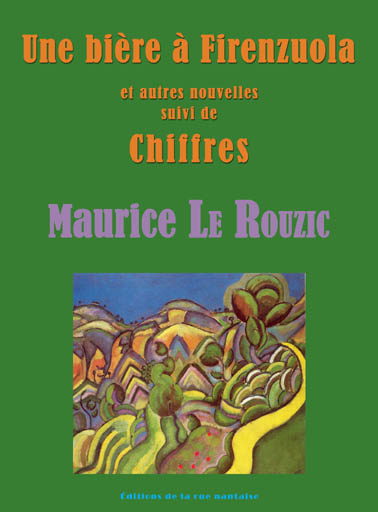Une bière à Firenzuola et autres nouvelles de Maurice Le Rouzic, recueil idéal pour échapper à la morosité, entraîne quiconque le savoure à travers la Croatie, l'Italie, l'île de Chypre, celle de Cuba, la Pologne, la République Tchèque, l'Angleterre, le Cambodge... La procession de pays enchante : les paysages défilent, les personnages se succèdent. Mais l'Histoire, toujours, vient se mêler aux décors colorés. De ce fait, Une bière à Firenzuola et autres nouvelles invite le lecteur à s'évader en voyageur éclairé, en homme conscient des autres et de ce qui l'entoure.
Maurice Le Rouzic présenta notamment ses nouvelles à la librairie Gargan'Mots à Betton le 19 octobre 2010.
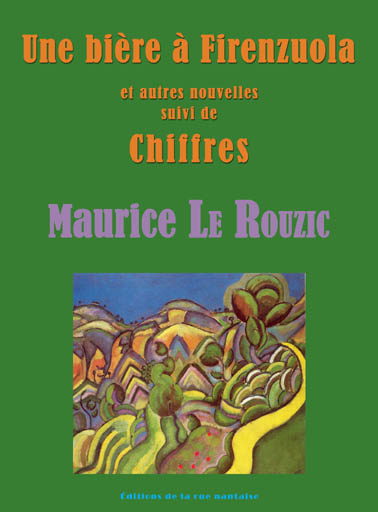
158 pages, 14,5 × 21 cm
14 euros
ISBN : 978-2-919265-02-2
EXTRAIT : « Tornade »
« Il est des expériences qui nous contraignent à tout réviser. »
François Bizot, Le Portail
Olivier s’était calé tout au fond de l’autobus. Au moins, il ne verrait pas la route devant lui avec son cortège de cyclistes, cyclomotoristes, véhicules à traction animale, engins motorisés en tout genre qui circulaient de manière anarchique et que le bus croisait ou doublait au petit bonheur la chance, à grand renfort de coups de klaxon, sans ralentir son allure. Je suis le plus gros, j’ai la priorité semblait être la devise du conducteur qui ne se départissait pas d’un flegme qui n’était peut-être qu’affiché.
Physiquement, Olivier ne se distinguait guère des autres passagers — sans doute un peu mieux habillé que la plupart d’entre eux. Il n’y aurait eu que sa langue et son prénom ! Les cheveux raides et très bruns, le visage mat, les yeux en amande : il avait tout de l’Asiatique qu’il était par sa naissance, de l’Asiatique qu’il était venu rechercher dans ce Cambodge apparemment apaisé.
Le bus avait quitté Siem Reap tôt dans la matinée et roulait sur la route nationale 6 qui laisse le lac Tonlé Sap sur sa droite lorsqu’on se dirige vers Phnom Penh. Un paysage plat, monotone défilait derrière la vitre poussiéreuse, heureusement agrémenté de hauts palmiers à sucre tels des vigies veillant sur les rizières asséchées. Çà et là le long de la route, isolées ou regroupées dans des sortes de hameaux, des habitations montées sur pilotis se haussaient du col dans une pauvre concurrence.
On était en avril. Le mois le plus chaud de l’année.
On approchait de Kompong Thom et le ciel, jusqu’à présent limpide, prenait des teintes légèrement plombées. La chaleur aidant, Olivier avait fini par s’assoupir. Il fut réveillé par un crépitement contre la tôle de l’autobus. Un éclair zébra l’horizon. Une pluie lourde, serrée, noyait le paysage. Le car avait fortement ralenti. Du revers de la main, Olivier balaya la buée qui recouvrait la vitre. De toute évidence, il avait dormi plus longtemps qu’il le pensait.
On avait atteint les faubourgs de Phnom Penh. Il n’y avait plus de rues, mais de véritables cours d’eau où les piétons pataugeaient jusqu’aux mollets. La noria des deux-roues n’avait cependant pas cessé : vélos avançant péniblement contre le flot, scooters avec leurs deux ou trois passagers genoux relevés à hauteur de poitrine, motos familiales creusant leur sillon à contre-courant. Même les voitures continuaient d’aller et venir, un peu plus lentement malgré tout. De petites vagues nées de toute cette circulation venaient lécher les pas de porte lorsqu’elles ne les avaient pas déjà submergés. Çà et là, sur les boulevards, un arbre était tombé, parfois sur un véhicule que, la scie à la main, les hommes tentaient de dégager.
Olivier regarda autour de lui. Le chauffeur, impassible, frayait son chemin dans cette apocalypse comme si de rien n’était. Les autres passagers ne semblaient pas davantage impressionnés. Certains même souriaient au spectacle de trois bonzes tentant de se protéger sous un minuscule parapluie ; d’autres commentaient peut-être — il ne comprenait pas ce qu’ils disaient — la manière dont un conducteur de touk-touk, armé d’un immense imperméable sous lequel il disparaissait, dirigeait son véhicule en prenant soin que ses clients ne soient nullement éclaboussés. Il comprit que pour tous ces gens, habitués à subir une rude saison des pluies, la seule surprise venait du mois où les éléments avaient décidé d’attaquer.
Était-elle due au bouddhisme ? Cette insouciance, presque de la passivité, face aux événements, l’avait frappé dès le jour de son arrivée. Ce n’était d’ailleurs pas son seul motif d’étonnement. Dès ses premières sorties dans les rues de Phnom Penh, quelque chose lui avait semblé étrange : depuis les heures fraîches du petit matin, jusqu’aux heures avancées de la nuit la foule grouillait, dense ; elle semblait sortir de partout comme par un phénomène inépuisable de génération spontanée ; pourtant, jamais il ne s’était senti oppressé. Une multitude envahissait les trottoirs, se massait dans les étroites allées des marchés couverts, circulait dans toute sorte de véhicules, se frayait des chemins on ne savait trop comment. Les rues regorgeaient de gens qui se frôlaient, s’effleuraient, se frottaient parfois, se heurtaient rarement. À tout cela, il avait fini par s’habituer, mais il y avait autre chose, une chose qu’il ne parvenait pas à déterminer et qui occasionnait chez lui, à chaque fois qu’il se trouvait plongé dans la cohue humaine, un malaise diffus.
Un matin, alors qu’il profitait de la relative tiédeur pour se promener le long des rives du Mékong, un groupe compact, des lycéens et des lycéennes à juger par leur uniforme, le doubla comme pressé de commencer les cours. Ils riaient, se chamaillaient gentiment, parlaient aigu. Alors l’évidence lui sauta aux yeux. Comment ne l’avait-il pas remarqué plus tôt ? Dans cette fourmilière, des jeunes, beaucoup ! Des gens âgés, presque des vieillards, également — bien moins nombreux cependant ! Entre les deux : rien, ou si peu ! Une génération absente, disparue, rayée, sacrifiée !
La génération de ses parents.
Celle qu’il était venu rechercher près de trente-cinq ans plus tard. Trente-cinq ans ! Son âge ! Il avait fallu un concours de circonstances pour qu’il revienne vers son pays natal. Dire qu’il n’y avait jamais songé ne serait pas la vérité, mais cette idée de retour aux origines ne l’obsédait pas. Cela faisait partie de ces projets un peu vagues que l’on envisage pour plus tard. Ils prennent consistance quelques jours à la suite d’un événement, d’une lecture particulière ou, tout simplement, parce qu’à ce moment-là rien d’autre de précis ne nous préoccupe. Ils retournent à leur existence souterraine dès lors que la vie reprend son cours. Ils n’ont pas disparu, se sont simplement enfouis sous des couches d’urgence ou soi-disant telle. Ils resurgissent, parfois violemment, lorsque, un jour, le destin se décide à les ressusciter des limbes où ils s’endormaient paisiblement.
C’est ce qui était arrivé à Olivier ce vendredi quand, alors qu’il se détendait après une semaine intense au lycée où il enseignait les mathématiques, le téléphone avait sonné.
*
Une voix blanche lui avait annoncé l’accident. Tout d’abord, il n’avait pas saisi. Il avait pensé à une erreur de numéro, puis la voix avait répété : la marque du véhicule, son immatriculation, le nom du conducteur, celui de la passagère. Tout correspondait, mais c’était comme des informations qui n’avaient rien à voir l’une avec l’autre. Après avoir raccroché, il lui fallut du temps pour que les connexions se fassent et que l’horrible réalité prenne corps. Pour la deuxième fois, il venait de perdre ses parents. Cette fois-ci, sur une route obscure du centre de la France. La première fois, il ne savait pas. Il était trop jeune.
Jean et Suzanne l’avaient élevé comme s’il avait été le véritable fils qu’ils n’avaient jamais pu avoir. Entre lui et eux, il y avait près de quarante ans. La première fois qu’ils étaient venus le chercher à la sortie de l’école, les autres enfants les avaient regardés avec surprise : Jean commençait déjà à grisonner, Suzanne avait le don de n’être jamais à la mode. Et puis l’ascendance asiatique d’Olivier était tellement évidente ! Très vite, ils lui avaient dit qu’ils l’avaient adopté tout petit. Dans quelles circonstances ? Ils étaient toujours restés dans une sorte de flou qui, après tout, lui convenait. Curieusement, il n’avait pas cherché à en savoir davantage. Ils l’aimaient. Ça lui suffisait. Les questions d’identité — qui suis-je ? D’où viens-je ?... — ne l’avaient jamais vraiment troublé. Bien sûr, il y avait eu des moments qui le renvoyaient brutalement à son origine : enfant quand il se faisait traiter de « chinetoque » par les autres gamins, à la puberté quand son corps devint une évidence, plus tard en classe de philosophie… Oui, à ces moments, il avait eu envie d’interroger ses parents, qu’ils lui en disent plus. À peine avait-il abordé le sujet, il les sentait si gênés, si malheureux même, qu’il n’osait pas insister.
C’est ainsi que, jusqu’à cet accident qui le laissait doublement orphelin, il avait vécu dans l’absence d’un passé. C’est ce passé qui revint à lui et le submergea lorsque, en tant qu’unique héritier, il dut prendre en main tous les problèmes liés à la succession de Suzanne et de Jean. Il hésita tout d’abord à se plonger dans des papiers qui lui semblaient trop intimes. Pourtant, il fallut bien. Il découvrit sur ses parents adoptifs, sur lui-même, toute une série d’éléments qu’il ignorait totalement — qu’il avait voulu ignorer ! — qui le laissèrent abasourdi. Ce n’était pas tant d’en prendre connaissance qui le déconcertait que de penser que, après toutes ces années où il avait vécu avec Jean et Suzanne, il les avait, au bout du compte, si peu connus.
Il apprit ainsi qu’ils avaient travaillé à Phnom Penh, dans les services consulaires de l’ambassade de France ; ambassade d’où ils avaient été évacués, avec une grande partie du personnel, dans les derniers jours d’avril 1975, deux semaines après la prise du pouvoir par les Khmers rouges ; ambassade qu’ils avaient quittée avec un bébé de quelques jours tout récemment adopté, les documents signés du consul en personne en attestaient sans conteste. Après cette révélation, il fut pris d’une frénésie d’en savoir davantage, mais il ne trouva rien qui fût en mesure de combler sa soudaine curiosité. Hormis les dossiers administratifs, les papiers d’état-civil, ceux qu’il est de toute façon nécessaire de conserver, il n’y avait rien. Pas une coupure de presse, même pas un bibelot qui pût évoquer ce Cambodge où ils avaient séjourné trois ou quatre ans. C’était comme si, une fois rentrés en France, Jean et Suzanne avaient voulu tout effacer, ne conservant de cette vie antérieure que celui qui était devenu leur bébé, un enfant aux yeux bridés mais au nom, au prénom, à l’éducation bien français ; comme si ce bébé, ils avaient voulu le protéger contre des démons. C’est du moins ainsi qu’il voulait l’interpréter.
À force de fouiller, de tout retourner dans ce qui restait de l’existence de ses parents, il finit par tomber sur une enveloppe. Elle était libellée au nom et à l’adresse de Jean et Suzanne, dans une calligraphie parfaite. Elle venait du Cambodge, les timbres où se dessinaient les cinq tours d’Angkor Vat en témoignaient. La date d’expédition n’était plus très lisible, 1981 sans doute. Elle était vide. Au dos, l’expéditrice avait noté son nom et son adresse. Olivier tressaillit. Longtemps, il tourna entre ses doigts ce banal objet si précieux pour lui. Il ne savait pas ce que sa démarche pourrait donner mais il décida qu’il écrirait. Il se laissait le temps de digérer cette découverte, de réfléchir à ce qu’il dirait. Mais c’était sûr, demain il écrirait.
Il déposa la lettre dans la boîte comme on jette une bouteille à la mer. Il y avait mis toute la diplomatie dont il était capable, y avait expliqué qui il était, comment il avait eu connaissance de l’adresse. Il y avait fait part de ses intuitions, de ses interrogations. Il avait essayé d’être le plus simple possible. Il ne savait pas si la Madame Hien de Kompong Cham à qui il expédiait cette missive lisait bien le français. L’enveloppe lui laissait penser que oui, mais le temps avait passé ! Et puis, habitait-elle toujours au même endroit, presque trente ans plus tard ? Vivait-elle encore ? Autant d’inconnues qui rendaient sa démarche des plus aléatoires. Pourtant lorsqu’il eut lâché le message, que celui-ci fut tombé au fond de la boîte à lettres, il se sentit plus léger. Il sut que, quelle qu’en fût l’issue, sa démarche était la bonne.
Restait désormais à attendre.
*
« Lorsque j’ai ouvert le courrier, je me demandais bien ce que j’allais y trouver. Je crois que, à la première lecture, je n’ai rien compris. Comme si tout mon français venait d’un seul coup de me quitter. J’ai lu et relu avant de réaliser enfin que tu étais vivant… Après combien ?... Trente-cinq ans ?... Oui, c’est l’âge que tu dois avoir aujourd’hui. Je me suis frotté les yeux. Des larmes y montaient. Je me suis assise. J’ai cru que mon cœur, plus très solide, allait éclater. »
À son tour, Olivier tournait et retournait le papier dans ses mains, comme il l’avait fait pour l’enveloppe quelques semaines auparavant. À son tour, il avait du mal à saisir ce que ses yeux y lisaient. À son tour, il dut reprendre plusieurs fois les mêmes mots, les mêmes phrases avant que tout s’enchaînât et fit sens. Non seulement, sa lettre était parvenue à destination, mais il avait une réponse ! Cette Madame Hien dont il n’avait jamais entendu parler avant de découvrir l’enveloppe vide était sa tante. Elle prétendait avoir beaucoup oublié de ce français qu’elle avait appris dans sa jeunesse, mais qu’elle écrivait encore fort bien. Elle lui parlait de sa sœur et de son beau-frère — la mère et le père d’Olivier — tous deux traducteurs à l’ambassade de France à Phnom Penh, de l’entrée des Khmers rouges dans la ville le 17 avril 1975. Elle était à Kompong Cham lorsque c’était arrivé. Les choses n’avaient pas traîné. Comme tous les citadins, elle avait dû abandonner son logement et toutes ses affaires personnelles, se fondre dans la masse des déplacés, marcher à ne plus sentir ses pieds, travailler dans les rizières, réciter un piètre catéchisme révolutionnaire, crier des slogans simplistes si éloignés de la réalité que seuls la peur et un efficace lavage de cerveau faisaient sortir de bouches bâillonnées. Surtout, effacer son passé : ne jamais laisser paraître qu’elle avait été institutrice, faire croire qu’elle ne parlait que le khmer, se méfier de tout le monde, vivre sans identité, survivre dans la terreur. Son quotidien pendant quatre longues années. Elle se demandait par quel miracle elle avait surmonté toutes ces épreuves, elle qui n’était pas une force de la nature. Elle s’interrogeait sur les ressources insoupçonnées de l’être humain.
Elle lui parlait aussi de Pierrot, un photographe de presse qu’elle avait rencontré en 1981, six ans après la catastrophe, deux ans après un retour à un semblant de normalité. Elle était venue à Phnom Penh. Elle cherchait à savoir ce qu’était devenue sa sœur, enceinte à l’époque où Pol Pot et les siens avaient pris le pouvoir. Il l’avait entendue déposer sa requête auprès d’un employé distrait. Il l’avait attendue à la sortie du bâtiment, l’avait hélée. Ils avaient eu une longue conversation.
Avril 1975. Il était au Cambodge pour un reportage dans le pays en ébullition. Comme beaucoup d’étrangers, il s’était réfugié dans les locaux de l’ambassade dès l’arrivée des libérateurs. Dans la foule qui s’entassait entre cour et bureaux, il avait rencontré Jean et Suzanne. Ils avaient vaguement sympathisé le temps de quelques jours. Le couple avait été évacué par le premier convoi. Lui avait dû attendre le second départ. Pas prioritaire. Il les avait vus qui embarquaient dans un camion bâché avec le nouveau-né qu’ils avaient adopté en dernier recours. Ils lui avaient donné leur adresse en France. Il avait suivi quelques jours plus tard. Il avait eu le temps d’apprendre que la mère du nourrisson, une traductrice locale, n’avait pas survécu à l’accouchement. Septicémie. Il ne savait pas ce qu’était devenu le père. Il craignait le pire. Il n’était jamais allé voir Jean et Suzanne. Aujourd’hui, ça lui faisait tout drôle de revenir dans ce pays qui s’appelait de nouveau Cambodge — fini la parenthèse cruellement ironique du Kampuchea démocratique. Il avait sorti de son portefeuille un petit papier tout froissé, tout passé. Le lui avait donné. Une adresse en France. Elle avait écrit. Elle n’avait jamais eu de réponse.
« Désormais, je ne suis qu’une vieille femme. Tu es jeune. Tu es tout ce qui reste de ma famille. Jusqu’à ces derniers jours, je n’attendais plus rien de la vie. Désormais, j’aurai au cœur l’espoir de te connaître, un jour. »
La lettre, la longue lettre, d’une calligraphie impeccable quoiqu’un peu tremblotante, se terminait ainsi.
Olivier s’essuya les yeux.
Sa décision était prise.
*
La « vieille femme » ne devait guère avoir beaucoup plus que soixante ans, mais son visage marqué, sa silhouette fragile, sa voix éraillée, tout contribuait à ce qu’on pût lui donner davantage d’années que celles effectivement vécues. Certaines avaient été si longues ! Elle habitait un tout petit appartement dans une des rues bruyantes du centre-ville de Kompong Cham, à deux pas d’un marché ouvert jour et nuit. Olivier s’était installé dans un vieil hôtel de style colonial aux couloirs larges comme des boulevards. De sa chambre, il avait une vue directe sur le Mékong et sur le pont suspendu — construit par les Japonais — qui permettait enfin de passer d’une rive à une autre sans avoir besoin de faire un long détour.
Ses premiers jours dans le pays, il les avait passés dans la fourmillante Phnom Penh, le temps de s’adapter quelque peu au rythme de l’Asie. Le temps aussi de quelques visites : le Palais Royal bien sûr, la colline de Madame Penh, ses pagodes, son grand stupa, ses singes quémandeurs, les rives du fleuve, plus aérées que les rues bondées et parfois malodorantes du cœur de la cité ; mais aussi Tuol Sleng, cet ancien lycée que les Khmers rouges avaient transformé en antichambre de la mort.
Le trop fameux S-21.
Dans ses minuscules cellules, dans ses chaînes solidement accrochées aux murs ou fixées au sol, sur ses misérables grabats de torture, il avait imaginé son père dont il reconstruisait les traits à travers les peintures de Vann Nath, rare rescapé et témoin de cet enfer. Cet enfant que des miliciens hilares tenaient par une jambe pour fracasser son crâne contre un arbre, ç’aurait pu être lui ! Il était aussi allé jusqu’à Choeung Ek, dans la banlieue de Phnom Penh, où cette scène s’était répétée à combien de reprises ! À Choeung Ek hanté par les milliers d’innocents ou autres — peu importe — qui y avaient été méthodiquement assassinés. À Choeung Ek, ce charnier à ciel ouvert aux portes de la capitale. Ces visites, il les avait vécues dans sa chair. Ces suppliciés, il les voyait au bord de la fosse où s’entassaient déjà plusieurs cadavres, les mains liées derrière le dos, attendant presque comme une délivrance que le bourreau frappât par derrière. Au moins, ça en serait fini de toutes les souffrances endurées ! Il se demandait si les os de son père reposaient là. Il en arrivait à bénir la septicémie qui avait emporté sa mère. À cette réalité qui lui crevait les yeux s’en superposait une autre : celle d’Auschwitz-Birkenau où il avait accompagné une classe quelques années auparavant, ces baraquements sinistres, ces restes de chambres à gaz, de fours crématoires où flotte encore l’odeur de la mort. Il se souvenait de ces jeunes Allemandes, en pleurs devant l’amoncellement de lunettes, de vêtements, de valises, de cheveux humains qui témoigne du massacre. Il se souvenait aussi de ces jeunes scouts, drapeau israélien au vent, qui chahutaient entre les ruines de Birkenau et que leurs accompagnateurs avaient bien du mal à ramener à un peu plus de dignité. Il se disait que la mémoire prenait des tours parfois pleins de paradoxes. Tuol Sleng, Choeung Ek : combien de jeunes Cambodgiens, aujourd’hui, côtoient ces lieux sans même savoir ce qu’ils représentent ? Alors, oui, il se disait qu’à l’image du Mékong, la mémoire est faite de méandres, de périodes de sécheresse et de périodes de crue. Le temps la dilue. Le temps la distend.
Madame Hien n’avait rien oublié.
Quand elle avait rencontré son neveu pour la première fois, ses yeux fatigués s’étaient embués. « C’est comme si je voyais en même temps ma sœur et mon beau-frère » avait-elle fini par lâcher après un long moment d’épais silence. Elle l’avait fait asseoir, lui avait servi du thé. Ce jour-là, les mots de sa tante — il ne lui restait aucune photo de ce qui avait été sa famille — avaient, pour Olivier, donné vie à celui et à celle qui lui avaient donné la vie.
Le lendemain, il était retourné la voir comme on va visiter un parent que l’on connaît de longue date. Elle n’avait pas voulu qu’ils restassent enfermés.
« Viens, je veux te montrer quelque chose. »
Elle l’avait entraîné dans la rue, l’avait laissé un moment sur le trottoir, était revenue quelques minutes plus tard dans un touk-touk où elle l’avait fait monter. Ils avaient roulé quelques kilomètres avant d’arriver devant un spectacle qui le laissa bouche bée : un bras du Mékong isolait un îlot relié à la rive par un pont qui semblait aussi fragile qu’une construction en allumettes.
« Tu vois, ce pont, il est en bambou. Tous les ans, il est emporté par les crues à la saison des pluies, tous les ans, il est reconstruit. »
Ils descendirent la sente de terre ocre qui y menait, s’engagèrent sur le mince ouvrage que traversaient des piétons, des deux-roues, des carrioles tirées par un cheval mais aussi des voitures où se serrait une nombreuse famille.
« Ça paraît fragile. C’est solide pourtant. »
Tout l’après-midi, malgré la chaleur, ils avaient marché, sur le pont, sur l’île jusqu’à la pagode où ils avaient trouvé un peu d’ombre. Le soir tombait lorsqu’ils rentrèrent. Tout l’après-midi, elle lui avait parlé de sa jeunesse, de ses études, du lycée où elle s’était prise d’amour pour la langue française. Il lui avait dit que lui avait été très tôt fasciné par les chiffres, les nombres, ces abstractions avec lesquelles il aimait jouer. Il en avait fait son métier. Madame Hien l’avait regardé bizarrement, l’air grave. « Au lycée, j’ai eu plusieurs professeurs de mathématiques. Il n’y en a qu’un dont je me rappelle le nom : Kaing Guek Eav. » Ce nom était sorti de sa bouche comme elle aurait craché un serpent. Olivier ne comprit pas. Elle le laissa à sa surprise et sembla changer de sujet.
« Tu sais qui j’ai revu ? Pierrot, tu sais, le photographe dont je t’ai parlé dans ma lettre. Presque trente ans déjà ! Il n’a pas beaucoup changé ! Le visage plus marqué, les cheveux plus blancs. Il a mon âge ou presque. Il ne travaille plus beaucoup, mais il m’a dit qu’il ne voulait pas manquer ça. »
C’était le mois dernier. Elle s’était rendue à Phnom Penh pour préparer l’arrivée d’Olivier. Elle voulait lui réserver une chambre dans un hôtel qu’elle connaissait. C’est là qu’elle avait rencontré Pierrot. Il était assis dans le hall et semblait attendre quelqu’un ou quelque chose. Elle l’avait abordé. Il n’avait pu cacher sa surprise. Qui était cette femme qui s’adressait à lui ?... Lorsqu’elle lui avait parlé de Jean et de Suzanne, la mémoire lui était revenue. Ils avaient parlé, le temps qu’arrive le taxi qu’il avait réservé. Le procès de Douch, l’ancien tortionnaire en chef de Tuol Sleng, avait débuté. Il connaissait un peu le Cambodge. Une agence de presse lui avait demandé s’il voulait suivre les débats, faire un reportage photographique. C’est pourquoi il était là. Le taxi était arrivé. Il allait y monter. Il s’était retourné. Pour lui dire au revoir, pensait-elle.
« Si vous avez le temps, venez avec moi. Je peux vous faire entrer dans la salle d’audience. » Elle avait accepté la proposition.
Elle savait très bien pourquoi.
*
« J’ai croisé les yeux de Douch ! »
C’est à peu près tout ce qu’elle avait retenu de cet après-midi. Les juges, les procureurs, les avocats — ils étaient nombreux, elle ne s’y repérait pas — avaient beaucoup parlé, en khmer, en anglais, en français, peut-être dans d’autres langues encore. Dans le box des accusés, un petit vieux propret qu’on n’aurait pas remarqué en le croisant dans une rue, visage impassible, relié au monde par une oreillette, suivait les débats comme s’ils ne le concernaient pas. Elle ne pouvait s’empêcher de le fixer. À un moment, il avait tourné son regard vers le public, comme aimanté par son regard à elle. Cela avait duré quelques secondes à peine.
« J’ai croisé les yeux de Douch ! »
Elle y avait reconnu ceux de Kaing Guek Eav, le seul professeur de mathématiques dont elle se rappelait le nom. Un jour, les élèves l’avait attendu. Il n’était pas venu. Il n’était plus jamais venu. Disparu. Envolé. Personne n’était capable de dire ce qu’il était devenu. Dommage ! Ce n’était pas un mauvais professeur. Celui qui l’avait remplacé, si !
« J’ai croisé les yeux de Douch ! »
Elle était encore sidérée par ce regard, un regard plutôt doux.
Le regard du bourreau !
Olivier ne se souvenait plus très bien de la suite de la conversation. Elle avait évoqué les autres : les Khieu Samphan, les Ieng Sary, tous ceux qui, comme Kaing Guek Eav, avaient disparu quelques années dans la jungle avant de resurgir comme maîtres du pays ; tous ces vieillards qui seraient morts avant d’être jugés ! Et il avait reconnu sur la langue de sa tante les mêmes serpents que lorsqu’elle avait prononcé le nom de son ancien professeur de mathématiques au regard d’agneau.
Tuol Sleng : même pas quatre ans d’existence. Quatorze mille morts au moins ! Combien d’autres vies broyées ? Pourquoi ? Pour quoi ?
Les yeux de Douch restaient muets.
*
C’est à tout cela que songeait Olivier dans le taxi qui le menait à l’aéroport. Dans trois heures, il monterait dans l’avion pour Singapour. De là s’envolerait pour Paris. Deux jours plus tard, il reprendrait son travail, un travail qu’il ne verrait plus comme avant, une vie qui prendrait un autre sens. Lequel ? C’est ce qu’il était bien incapable de projeter. Il lui faudrait sans doute quelques semaines, quelques mois, pour que ce nouvel avenir se dessine avec plus de netteté. Après ces quelques jours en compagnie de sa tante, il avait voulu se muer en touriste ordinaire. Il avait embarqué dans un bus. Direction Siem Reap, la porte de la mythique Angkor. Il avait admiré les temples, les cités exhumées de la jungle, l’art, l’architecture de ces civilisations perdues. Pourtant les yeux de Douch ne le quittaient pas. Ils étaient sur les panneaux qui avertissaient de ne pas sortir des sentiers balisés par crainte de mines qui auraient été oubliées. Ils étaient dans les moignons des innocentes victimes qui tentaient de survivre en proposant aux visiteurs l’achat de livres-témoignages sur le martyre vécu par un pays entier. Ils étaient sur les haillons des enfants qui quémandaient quelques riels en échange de pacotilles ou de cartes postales. Ils étaient sur les deux cent seize visages de l’impénétrable Jayavarman VII qui, de tous les angles du temple de Bayon, cœur de l’ancienne cité d’Angkor Thom, surveillait son domaine de pierre. Combien de morts pour en arriver à ces ruines que la forêt avait englouties pendant plusieurs siècles ?
Le taxi se frayait un chemin dans la foule qui envahissait la chaussée : ouvrières du textile arrachées à leur campagne pour gagner les quelques malheureux dollars qui leur permettraient à peine de survivre, jeunes filles aux jambes nues sur leurs scooters, familles à quatre ou cinq sur une antique moto, touristes à la recherche d’un touk-touk ou de tout autre moyen de locomotion, voitures que seule l’habitude faisait encore rouler. Tout cela se croisait, s’évitait, s’effleurait, klaxonnait. Olivier ne savait pas si son jeune chauffeur faisait davantage confiance à la figure du Bouddha qui trônait sur le tableau de bord, à son instinct ou à sa connaissance du terrain. Le fait est qu’il avançait en fredonnant un air à la mode.
Le jour de leur évacuation, c’est sans doute le cœur serré, soulagés pourtant, que Jean et Suzanne, protégeant le poupon qu’ils amenaient avec eux, avaient vu disparaître la ville qui s’éloignait.
Instinctivement, Olivier se retourna comme pour un au revoir à ce pays — son pays ? — qui l’avait vu naître.
Hormis quelques flaques çà et là, le long des trottoirs ou dans les nombreux trous de la chaussée, il ne restait plus trace de la tornade de la veille.
* * *